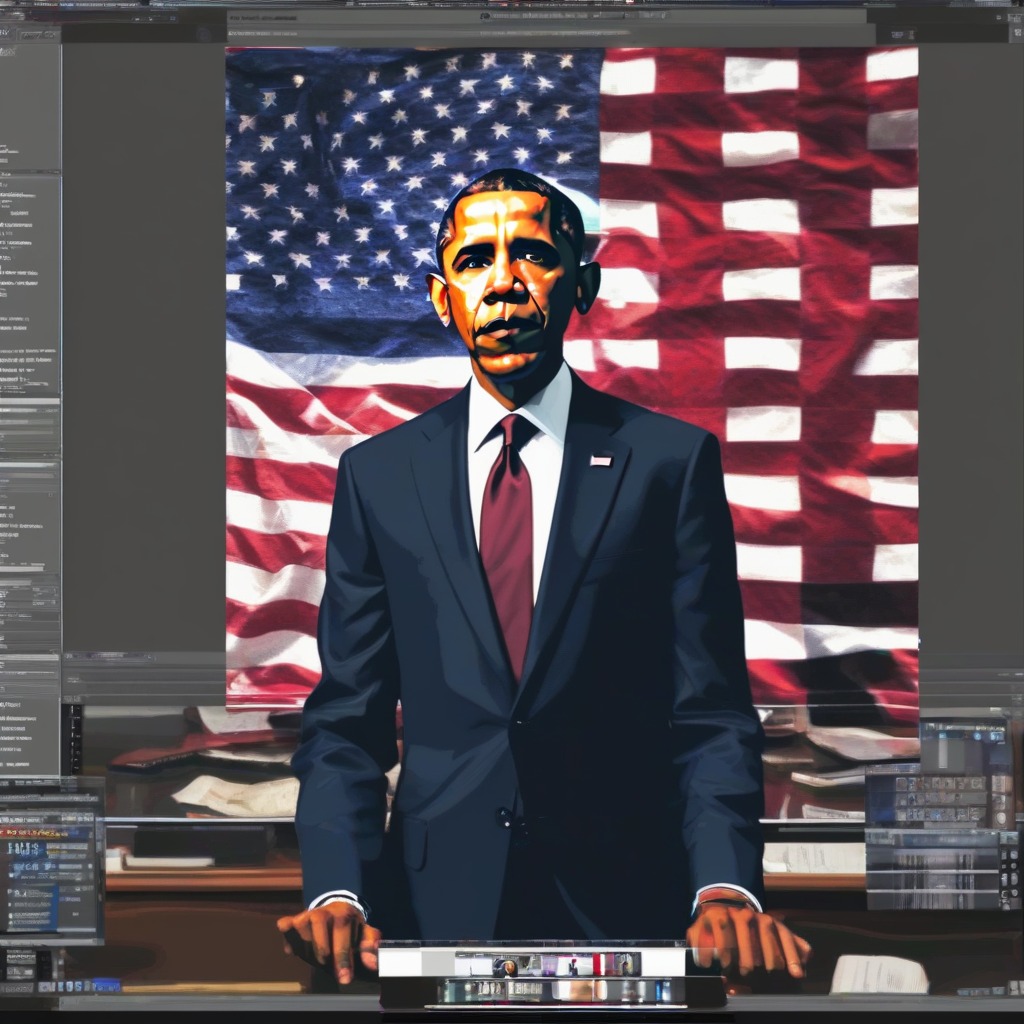Le contexte
Récemment, une vidéo deepfake mettant en scène Barack Obama arrêté par le FBI dans le Bureau ovale a fait le tour du monde. Cette vidéo, partagée par Donald Trump sur son réseau social, a soulevé des questions sur la légalité de la publication de contenus de ce type.
La situation aux États-Unis
Aux États-Unis, la question de l’utilisation de l’IA et des deepfakes est abordée sous un angle libertaire. Plusieurs projets de lois fédérales visent à encadrer l’usage des deepfakes, mais la régulation reste morcelée et les sanctions varient selon le type de contenu et l’État. La liberté d’expression, protégée par le Premier Amendement, prime sur les restrictions, sauf si la vidéo générée relève de la diffamation, de l’incitation à la haine ou de la tentative de manipulation électorale.
La situation en France
En France, la loi est plus stricte. Depuis la loi SREN de 2024, il est interdit de publier ou partager un contenu image, audio ou vidéo représentant une personne sans son consentement, si le caractère artificiel de la production n’est pas clairement explicité ou immédiatement perceptible.
Comparaison entre la France et les États-Unis
Entre la France et les États-Unis, ce sont deux manières diamétralement opposées de concevoir la liberté en ligne qui s’affrontent. D’un côté, la priorité est donnée à la prévention de la tromperie et à la protection des personnes. De l’autre, la défense absolue de la liberté d’expression laisse davantage d’espace à la satire et au risque de confusion, au nom du débat public.
Conclusion
En fin de compte, le dilemme des deepfakes soulève des questions fondamentales sur la liberté d’expression, la protection des personnes et la responsabilité des auteurs de contenus en ligne. Il est essentiel de trouver un équilibre entre la défense de la liberté d’expression et la prévention de la tromperie et de la manipulation.